Nathalie Bedoin est enseignant-chercheur à  l’Université Lyon 2 et au laboratoire CRNL (Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon) au sein de l’équipe Trajectoires. Docteur en psychologie, elle est spécialisée en recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des troubles neuro-développementaux (notamment la dyslexie), des troubles développementaux du langage (dysphasie), et des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), chez l’enfant et l’adulte.
l’Université Lyon 2 et au laboratoire CRNL (Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon) au sein de l’équipe Trajectoires. Docteur en psychologie, elle est spécialisée en recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des troubles neuro-développementaux (notamment la dyslexie), des troubles développementaux du langage (dysphasie), et des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), chez l’enfant et l’adulte.
À l’heure où le sujet de l’accessibilité numérique est sur toutes les lèvres, les marques se creusent la tête pour rendre leurs services plus inclusifs. Si les handicaps les plus courants (troubles visuels, auditifs, ou moteurs) arrivent en tête des considérations, qu’en est-il des troubles cognitifs, ces handicaps invisibles qui affectent plus de 15% de la population française ? Pour en savoir plus, nous avons discuté avec Nathalie Bedoin, spécialiste des troubles cognitifs.
Claire-Émilie Lecocq : Dans le monde, 1 milliard de personnes vivent avec un handicap dont des troubles visuels ou cognitifs comme la dyslexie. D'abord, qu'est-ce qu'avoir un trouble cognitif ?
Nathalie Bedoin : Les troubles cognitifs se caractérisent par le fait qu’il s’agit d’un handicap invisible. Pour cette raison, il est souvent non pris en compte par l’entourage, par manque de connaissance du problème. L’invisibilité du handicap fait que ses effets sur le comportement ou les compétences des personnes concernées peuvent être mal interprétés, puisqu’il n’y a pas d’indice évident de pathologie. Ces troubles peuvent être présents dès le plus jeune âge (dyslexie, dysphasie, dyscalculie, TDAH, …) – le trouble est alors qualifié de “développemental” – ou être consécutif à une lésion cérébrale survenue à la suite d’un AVC, d’une chute, d’un traumatisme crânien ou encore d’une tumeur – on parle alors de trouble “acquis”.
Pourquoi parle-t-on de handicap invisible ?
L’invisibilité d’un tel handicap s’explique souvent par les efforts des personnes pour dépasser leurs difficultés, parfois pour les masquer. Cette invisibilité tient également au fait que les personnes atteintes de déficits cognitifs ont souvent une difficulté seulement dans un domaine particulier. C’est la grande différence avec le retard intellectuel général par exemple, plus évident aux yeux d’autrui et parfois accueilli avec plus d’indulgence.
Ces troubles peuvent concerner la compréhension d’un débit de parole rapide, la lecture, l’écriture, la mémorisation de nouvelles informations, l’orientation parmi des informations multiples, le fait d’effectuer deux choses en même temps, d’effectuer un calcul mental, de se concentrer pendant un temps long, de se repérer sur un plan, de vérifier la monnaie rendue, ... Ces difficultés peuvent passer relativement inaperçues chez une personne qui, par ailleurs, réfléchit et vit ses émotions de la même manière que les autres.
Dans un tel contexte, l’adaptation globale de l’individu est possible, mais avec un handicap qui reste une source de difficulté, de fatigue, parfois de souffrance ou de honte, d’autant plus lorsque l’entourage l’ignore et se méprend lors d’erreurs surprenantes ou d’une lenteur inhabituelle dans la réalisation d’une activité particulière. Il est assez courant de souffrir, en plus du trouble cognitif, d’une faible estime de soi, et d’une forte anxiété, souvent là aussi mal comprises par l’entourage, et qui peuvent s’améliorer avec une prise en charge et une écoute adaptées.
Qu’est-ce que ces types de troubles – comme la dyslexie – impliquent pour les personnes qui en souffrent dans leur quotidien ?
De nombreuses personnes touchées par des troubles cognitifs le sont dès l’enfance. La bonne nouvelle, c’est que l’école les prend de plus en plus en compte, pour accompagner les enfants souffrant de ce type de troubles dans leur développement cognitif, selon des étapes et un rythme différents. Toutefois, si un tel handicap n’est jamais complètement résolu, il a tendance à devenir invisible à l’âge adulte. Après le lycée, les déficits cognitifs sont souvent considérés comme disparus, ce qui n’est qu’une apparence.
Avec le temps, les personnes atteintes d’un trouble cognitif développent des stratégies pour contourner leurs difficultés, éviter certaines situations, ou résoudre les problèmes différemment : ils s’adaptent. Mais ces stratégies sont coûteuses en énergie et peuvent les détourner d’activités qui pourtant leur plaisent ou seraient à plusieurs égards à leur portée. Un choix de voie professionnelle par défaut est souvent le lot de ces personnes, et il en résulte parfois une certaine frustration.
On voit, et vous l’avez mentionné, des aménagements à l’école, qu’en est-il pour les adultes ?
Il n’y a presque aucun aménagement dans les études supérieures ou dans le monde professionnel. Par exemple, au travail, de plus en plus d’activités dépendent d’un écran, de l’aisance à manipuler clavier et souris et de l’habileté à accéder à l’information et à communiquer au moyen de l’informatique. Les logiciels se multiplient, les informations foisonnent, les organisations varient et de nombreuses règles d’utilisation et d’interactions demeurent implicites, tout en attendant des employés toujours plus de rapidité et d’agilité à s’adapter à la nouveauté. Le recours plus fréquent au télétravail dernièrement accentue encore ces attentes et les difficultés pour les personnes souffrant de troubles cognitifs, comme la transformation des cours et des réunions en visioconférence, et les échanges glissant de l’oral (discussion dans un couloir ou à la machine à café) à l’écrit (par emails).
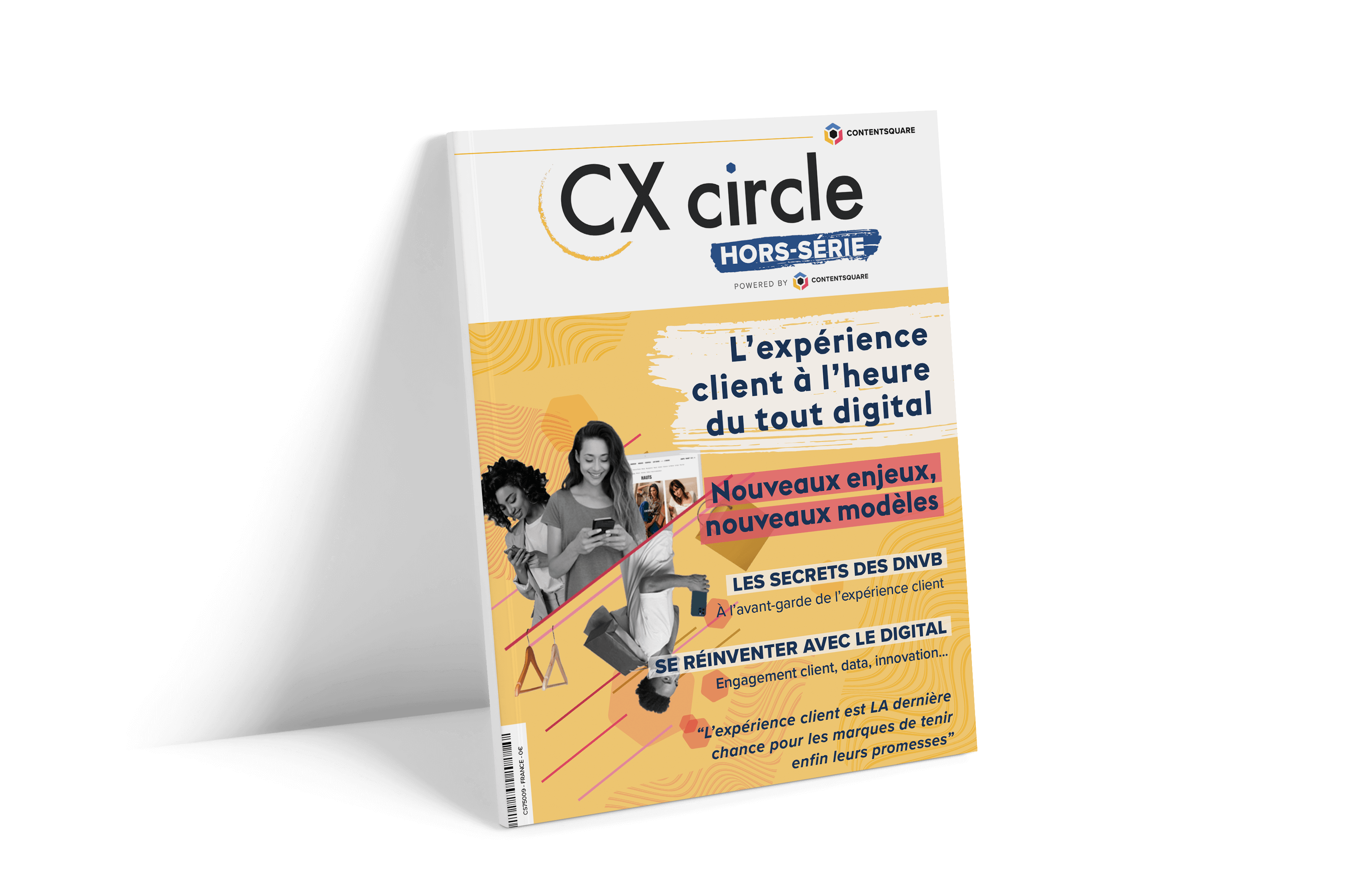
Découvrez le Hors-Série du Magazine de l’Expérience Digitale
> Comprendre les nouvelles attentes des consommateurs
> Pérenniser ces évolutions




